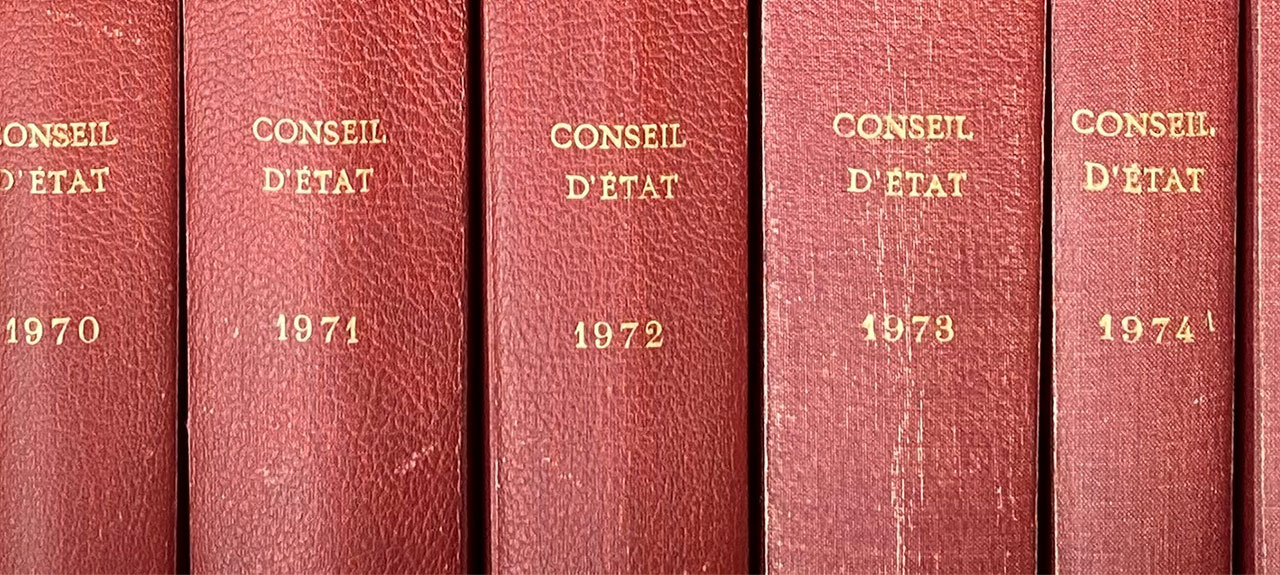Nécessité d’agir également en annulation du permis d’urbanisme
Depuis la réforme du Conseil d’État par la loi du 20 janvier 2014 portant réforme de la compétence, de la procédure et de l’organisation du Conseil d’État, il n’est plus possible d’introduire une requête en suspension ordinaire contre un acte administratif (tel un permis d’urbanisme) préalablement à l’introduction d’une requête en annulation.
La requête en suspension sera dès lors :
- soit introduite en même temps que la requête en annulation si l’urgence le commande
- soit postérieurement si la condition de l’urgence n’était pas rencontrée au moment du dépôt de la requête en annulation mais qu’elle le devient suite à la survenance d’un évènement nouveau.
L’importance du timing pour agir en suspension du permis d’urbanisme
Choisir le bon timing pour agir en suspension devant le Conseil d’État contre un permis d’urbanisme, voire pour décider d’introduire une suspension d’extrême urgence contre ce dernier, n’est pas chose aisée.
Deux arrêts rendus par le Conseil d’État du 23 février 2022 donnent quelques indications à ce sujet.
Dans l’arrêt n°253.078, le Conseil d’État rappelle que :
Selon l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État, la suspension de l’exécution d’une décision administrative suppose notamment une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation.
L’urgence ne peut cependant résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain. Une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties. Elle ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte ou du règlement attaqué présente des inconvénients d’une suffisante gravité, telle que, s’il faut attendre l’issue de la procédure en annulation, il risque de se trouver « dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles » (Doc. parl. Sénat, session 2012-2013, n°5-2277/1, p. 13) ».
Dans l’arrêt n°253.079, le Conseil d’État précise que:
Seuls les éléments emportant des conséquences d’une gravité suffisante sur la situation personnelle de la partie requérante sont susceptibles d’être pris en compte.
Il juge également que la condition de l’urgence présente deux aspects :
- une immédiateté suffisante
- et une gravité suffisante.
La loi n’exige pas l’irréversibilité de l’atteinte (contra C.E. n°251.210 du 6 juillet 2021), mais permet que la suspension évite de sérieuses difficultés de rétablissement de la situation antérieure.
Selon le Conseil d’État, c’est notamment le cas dans l’hypothèse où un permis serait annulé après la construction de l’immeuble ou d’une partie de celui-ci (arrêt n°253.078).
Déterminer le moment pour agir en suspension contre un permis d’urbanisme
Lorsqu’un riverain entend empêcher la mise en œuvre d’un permis d’urbanisme et souhaite dès lors obtenir la suspension de ses effets par le Conseil d’État, il lui est conseillé d’écrire au bénéficiaire du permis afin de lui demander s’il entend ou non mettre son permis en œuvre à brève échéance.
Le Conseil d’Etat estime en effet qu’« il appartient au requérant de vérifier de manière proactive si et quand le permis d’urbanisme dont il demande l’annulation risque d’être mis en œuvre », étant entendu que sous réserve des cas de suspension expressément prévus par la loi, « un tel permis est exécutoire dès sa délivrance » (arrêt n°235.160 du 3 mars 2022).
Dans les deux affaires soumises au Conseil d’État, le conseil du bénéficiaire du permis a adressé un courrier au requérant ou à son conseil.
Si les travaux ne sont pas prévus à brève échéance
Dans la première affaire (n°253.078), le conseil du bénéficiaire du permis d’urbanisme a fait savoir qu’aucune décision n’a été prise quant à la prise de cours du chantier et qu’il est possible qu’il débute avant l’aboutissement d’une procédure en annulation mais que ce ne sera pas avant plus d’un an et demi, voire davantage.
Dans ce contexte, le Conseil d’État juge qu’« étant donné que le début des travaux n’aura pas lieu avant de nombreux mois, il n’est pas établi à suffisance que le traitement de l’affaire en annulation ne puisse suffire à éviter les atteintes aux intérêts mis en avant par les requérants ».
En l’absence d’immédiateté suffisante des inconvénients dénoncés par la partie requérante, le Conseil d’État juge que la condition de l’urgence en référé n’est pas établie.
Si les travaux sont prévus à plus brève échéance
Dans le deuxième cas (n°253.079), le conseil du bénéficiaire du permis d’urbanisme a précisé dans un courrier du 30 août 2021 que ce dernier entendait commencer les travaux « « dans un délai de trois à quatre mois », à savoir aux environs des mois de décembre 2021 ou janvier 2022 ».
Face à une telle échéance (quatre à six mois), le Conseil d’État juge qu’il « est plausible qu’un éventuel arrêt d’annulation ne pourra intervenir dans un délai utile pour prévenir les inconvénients allégués, qualifiés de graves ».
Il admet dès lors l’urgence.
En résumé, lorsque la mise en œuvre d’un chantier est annoncée a échéance plus ou moins rapprochée (six mois ou moins dans l’exemple cité), il est opportun d’agir en suspension.
Si elle n’est pas annoncée ou qu’elle l’est mais à plus long terme (plus d’un an et demi dans l’exemple cité), l’urgence risque de ne pas être retenue. Il est alors conseillé d’agir dans un premier temps en annulation et, dans un deuxième temps, d’introduire une requête en suspension ou en suspension d’extrême urgence lorsque le requérant aura acquis la certitude que le permis sera mis en œuvre prochainement (avis d’affichage, arrivée d’engins de chantier, début de travaux, …).
En cas d’extrême urgence, la diligence s’impose mais ne suffit pas !
S’il entend agir par le biais de la procédure de suspension d’extrême urgence à l’encontre du permis litigieux, le requérant doit également réunir deux conditions :
- l’imminence de l’atteinte aux intérêts du requérant qui serait causée par l’exécution immédiate du permis et qui ne pourrait dès lors pas attendre la fin de la procédure en suspension ordinaire
- et la diligence du requérant à prévenir cette atteinte et donc à saisir le Conseil d’État (C.E. n°251.210 du 6 juillet 2021).
Agir sans attendre
Par conséquent, dès qu’il a connaissance d’un élément ne laissant pas de doute quant à l’imminence du début des travaux, le requérant doit agir sans attendre, le Conseil d’État estimant par exemple que cette condition n’est pas remplie lorsque la requête en extrême urgence est introduite plus de deux semaines près l’affichage du début imminent des travaux (C.E. n°251.210 du 6 juillet 2021).
Avoir fait preuve de proactivité pour s’informer
Lorsque la requête en suspension d’extrême urgence suit une requête en annulation, le requérant doit par ailleurs avoir fait preuve de la proactivité nécessaire « pour s’assurer de se prémunir, en temps utile, des dommages qu’elle craint de subir du fait de l’exécution de l’acte attaqué » (arrêt n°253.445 du 1er avril 2022).
Dans l’hypothèse où un recours en annulation a déjà été introduit contre un permis, le Conseil d’État estime que pour répondre à une telle condition, il ne suffit pas d’introduire une requête en suspension d’extrême urgence dans les dix jours de la communication, par la bénéficiaire du permis, de son intention de commencer les travaux quinze jours plus tard.
Dans une telle hypothèse, le requérant doit également être en mesure de démontrer qu’on a entrepris des démarches antérieurement pour connaître les intentions du bénéficiaire du permis quant à sa mise en œuvre du permis.
Le Conseil d’État estime qu’une telle condition n’est pas remplie si la partie requérante a pris contact avec le bénéficiaire du permis concomitamment à l’introduction de sa requête en annulation (19 juillet 2021) mais est « ensuite restée inactive durant plus de sept mois et a attendu d’être informée d’une mise en œuvre imminente par la partie adverse pour introduire la demande de suspension de l’exécution de l’acte attaqué, selon la procédure d’extrême urgence » (arrêt n°253.445 du 1er avril 2022)..
En d’autres termes, agir en suspension ou en suspension d’extrême urgence contre un permis d’urbanisme exige de la partie requérante qu’elle s’informe régulièrement de l’évolution du calendrier du bénéficiaire du permis.
En l’absence de réponse ou quand la réponse ne donne pas l’assurance d’une mise en œuvre à plus ou moyen terme permettant, le cas échéant, l’introduction d’une demande en suspension, le requérant doit réitérer à intervalles réguliers ses démarches vis-à-vis du bénéficiaire du permis afin de se garantir d’agir utilement en extrême urgence si ce dernier se décide soudain d’exécuter son permis à brève échéance.
Les pièges de procédures sont donc nombreux ! Pour toute question relative aux recours en matière de permis d’urbanisme, vous pouvez prendre contact avec Alexandre Patenostre ou Fabien Hans.