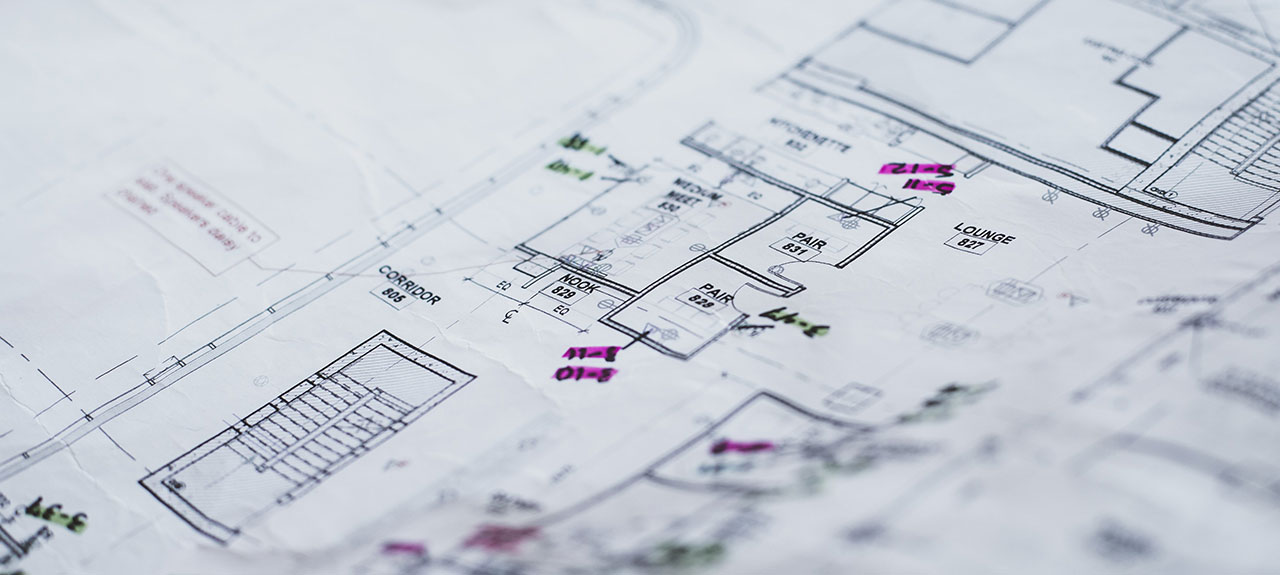Extension du champ d’application de l’amnisitie
Depuis la loi du 29 mars 1962 « organique de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme », toute personne qui maintient des actes et travaux réalisés sans permis, en contravention à un permis, etc., se rend coupable d’une infraction indépendante de « maintien ».
Cette situation insécurise un grand nombre de transactions immobilières.
L’infraction de maintien est « continue », dans la mesure elle ne prend fin que par la remise des lieux dans leur état initial ou par l’obtention d’un permis de régularisation. Tant que ce n’est pas le cas, l’infraction subsiste et se transmet en même temps que le bien, chaque nouveau propriétaire en devenant le titulaire.
Depuis 1962, le nombre de biens affectés d’une ou plusieurs infractions d’urbanisme n’a cessé d’augmenter. En outre, le temps qui passe et les nombreuses évolutions législatives rendent difficile la démonstration de l’éventuelle régularité des actes et travaux effectués sans permis à un moment donné.
Une évolution positive dès 2018
Dès la première modification du CoDT en 2018, le législateur wallon a prévu plusieurs tempéraments à l’infraction de maintien.
Ainsi, il précise que les actes et travaux réalisés sans permis, en violation du permis, etc. avant le 21 avril 1962 ne constituent pas des infractions. Il en est de même pour les divisions d’immeubles en plusieurs logements (sans travaux soumis à permis) réalisées avant le 20 août 1994.
ll prévoit aussi une amnistie pour les actes et travaux effectués sans permis avant le 1er mars 1998, à l’exclusion de quatre types d’infractions considérées comme les plus graves.
L’amnistie procure un double avantage :
- Non seulement les actes et travaux concernés ne peuvent plus faire l’objet de poursuites pénales ni des lourdes sanctions civiles susceptibles d’être imposées en cas d’infraction.
- Mais, en plus, ils sont considérés, de manière irréfragable, comme réguliers sur le plan urbanistique. En d’autres termes, ils font l’objet d’un permis de régularisation tacite.
Le législateur wallon a également créé un double mécanisme de dépénalisation. Selon ce dernier, les infractions non fondamentales étaient dépénalisées après 10 ans et les infractions fondamentales l’étaient après 20 ans. Cette dépénalisation n’était toutefois pas possible pour les actes et travaux relevant des quatre exceptions privées d’amnistie.
À l’inverse, si les actes et travaux « dépénalisés » ne peuvent plus donner lieu à des poursuites, ils restent irréguliers sur le plan administratif. Par conséquent, leur situation reste incertaine sur le plan administratif.
En 2024 – Extension de l’amnistie
Dans le décret du 13 décembre 2023, le législateur wallon tire les conséquences du caractère peu adéquat de la dépénalisation. Il décide en conséquence d’étendre l’amnistie aux actes et travaux « dépénalisés ». Voici ce qu’il faut en retenir :
Cinq catégories d’infractions « majeures » ne sont toujours pas susceptibles d’amnistie. Il s’agit des actes et travaux qui :
- ne sont pas conformes à la destination de la zone du plan de secteur dans laquelle ils se trouvent ;
- consistent en la création de plusieurs logements après le 20 août 1994 ;
- ont été réalisés sur un bien ou dans un site qui fait l’objet d’une mesure de protection particulière ;
- contreviennent à d’autres réglementations (Code du logement, permis d’environnement, etc.) ;
- ont fait l’objet d’une décision de justice passée en force de chose jugée.
Les infractions « mineures » ou « ordinaires » sont « pardonnées » passé un certain délai
Hormis ces exceptions, les actes et travaux identifiés comme des infractions non fondamentales ou mineures sont « irréfragablement présumés conformes au droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme » après dix ans. Pour les infractions fondamentales ou ordinaire, c’est après vingt ans.
Pour relever de la catégorie des infractions mineures, les actes et travaux en infraction doivent respecter des conditions cumulatives suivantes :
- Avoir été réalisés dans une zone destinée l’urbanisation ou sur un immeuble dont la situation en dérogation au zonage est régulière ;
- Être conforme aux normes du guide régional d’urbanisme ;
- Rencontrée les hypothèses détaillées à l’article D.VII.1, § 2, 3° du CoDT (notamment en termes de proportion d’écart autorisées).
La mise en place de ce système d’amnistie « glissante » permettra de régulariser la situation nombreux biens affectés d’une ou plusieurs infractions de moindre importance. Elle devrait faciliter la vie de bon nombre de propriétaires.
Permis de régularisation
Suspension de l’instruction de la demande de permis en cas de PV
Comme auparavant, une demande de permis de régularisation peut être introduite avant ou après un procès-verbal de constat. Toutefois, en cas de notification d’un procès-verbal après l’introduction de la demande de permis de régularisation, le CoDT prévoit dorénavant une suspension des délais d’instruction de cette demande afin de permettre au Procureur du Roi de notifier son intention de poursuivre ou non le contrevenant.
À défaut de poursuite, l’instruction de la demande de permis par l’autorité compétente reprend.
En cas de refus de permis, le contrevenant fait l’objet de poursuites soit devant le Tribunal correctionnel ou par le Fonctionnaire délégué devant le Tribunal de première instance.
L’octroi du permis est conditionné au paiement de l’amende administrative
En cas d’octroi du permis de régularisation, ses effets sont suspendus jusque la date du paiement de la transaction proposée par le Fonctionnaire délégué, en accord avec la Commune, au contrevenant de payer.
Ce n’est dès lors qu’une fois le montant de la transaction payé que le permis est notifié à son titulaire.
L’absence de paiement de la transaction dans les six mois de la demande entraine la péremption du permis de régularisation.
Vous avez une question concernant les infractions d’urbanisme en Région wallonne ? N’hésitez pas à contacter Me Alexandre Paternostre